 Peut-on être heureux à l’ombre du Vésuve ? Peut-on être heureux lorsqu’on est pauvre et orphelin ? En lisant le roman d’Erri de Luca, Le jour avant le bonheur, tout lecteur sensé répondra par l’affirmative. Car les quelques pages de ce court roman sont un condensé d’apprentissage du bonheur… malgré tout.
Peut-on être heureux à l’ombre du Vésuve ? Peut-on être heureux lorsqu’on est pauvre et orphelin ? En lisant le roman d’Erri de Luca, Le jour avant le bonheur, tout lecteur sensé répondra par l’affirmative. Car les quelques pages de ce court roman sont un condensé d’apprentissage du bonheur… malgré tout.
Nous sommes à Naples quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Le narrateur est orphelin et il vit en compagnie et sous la protection de don Gaetano, concierge d'un immeuble du centre historique de la ville. En une petite centaine de pages, le jeune garçon grandit, apprend la littérature et les jeux de cartes, apprend la vie et l'amour, apprend la violence et la mort et, à la fin du récit, il doit fuir vers l'Argentine comme l'a fait don Gaetano en son temps: il doit renoncer à Naples, la ville qui lui a appris le bonheur ("Je dois t'apprendre et je dois te perdre").
Bien sûr, au coeur du récit et de l'apprentissage du narrateur, il y a une jeune fille, entrevue dans l'enfance ("Le jour avant le bonheur n'était pas encore arrivé pour moi"), jamais oubliée et qui fera connaître au jeune garçon le bonheur puis le malheur le temps d'un été. Car Naples la généreuse, gorgée de soleil, sait aussi se montrer impitoyable envers ses enfants, au pied toujours menaçant du volcan.
Erri de Luca a écrit un roman d'apprentissage comme chacun d'entre nous aime à en lire car on y trouve toujours quelque chose de nos propres années d'enfance. Le récit est court mais truffé de merveilleuses et savoureuses remarques sur les livres (les enfants qui jettent les livres des parents sans savoir que c'est un peu de leur vie qu'ils font disparaître), le bonheur ("J'ai appris ainsi qu'on oublie le bonheur le jour après"), la ville ("La nuit, la ville est une poche retournée"), l'éducation ("Dans les têtes entrait la lumière, comme il en entrait dans la salle").
Le bonheur après ce livre reste un grand bonheur.



 Se souvient-on encore qu'il y a trente ans à peine, trente ans déjà, la démocratie espagnole a failli disparaître, le temps d'une nuit, celle du 23 février 1981, le temps d'un instant, celui de l'intervention de militaires rebelles à l'intérieur du Parlement espagnol? C'est sur cet "instant" que revient Javier Cercas, dans un essai proche de la chronique:
Se souvient-on encore qu'il y a trente ans à peine, trente ans déjà, la démocratie espagnole a failli disparaître, le temps d'une nuit, celle du 23 février 1981, le temps d'un instant, celui de l'intervention de militaires rebelles à l'intérieur du Parlement espagnol? C'est sur cet "instant" que revient Javier Cercas, dans un essai proche de la chronique:  N'y aurait-il pas tromperie sur la marchandise, se demande-t-on en refermant
N'y aurait-il pas tromperie sur la marchandise, se demande-t-on en refermant  Comment ne pas apprécier un livre qui commence sur ces deux phrases courtes et décisives: "Je pourrais peut-être vivre sans écrire. Je ne crois pas que je pourrais vivre sans lire"? Alberto Manguel, écrivain né argentin et devenu canadien, énonce donc le fond de sa pensée dès le début de son essai
Comment ne pas apprécier un livre qui commence sur ces deux phrases courtes et décisives: "Je pourrais peut-être vivre sans écrire. Je ne crois pas que je pourrais vivre sans lire"? Alberto Manguel, écrivain né argentin et devenu canadien, énonce donc le fond de sa pensée dès le début de son essai  Il y a dans les lettres américaines contemporaines, si foisonnantes et si fascinantes (voilà sans doute la remarque typique d'un européen à la fois fasciné et agacé par les reflets du (faux) mythe américain sans cesse renouvelé), il y a donc une sorte de petit refrain familier que l'on écoute en sourdine d'un récit à l'autre, une façon si particulière de raconter, sur un ton tour à tour grave et drôle, l'histoire de mecs normaux pas tout à fait si normaux que cela. Et c'est le cas du roman de Pete Dexter, intitulé
Il y a dans les lettres américaines contemporaines, si foisonnantes et si fascinantes (voilà sans doute la remarque typique d'un européen à la fois fasciné et agacé par les reflets du (faux) mythe américain sans cesse renouvelé), il y a donc une sorte de petit refrain familier que l'on écoute en sourdine d'un récit à l'autre, une façon si particulière de raconter, sur un ton tour à tour grave et drôle, l'histoire de mecs normaux pas tout à fait si normaux que cela. Et c'est le cas du roman de Pete Dexter, intitulé  Il y a des années de cela, j'ai découvert la beauté minérale du site archéologique de Tiahuanaco en Bolivie et voilà qu'au hasard d'une déambulation dans une librairie de Valencia, en Espagne, je mets la main sur un roman de Matilde Asensi,
Il y a des années de cela, j'ai découvert la beauté minérale du site archéologique de Tiahuanaco en Bolivie et voilà qu'au hasard d'une déambulation dans une librairie de Valencia, en Espagne, je mets la main sur un roman de Matilde Asensi, 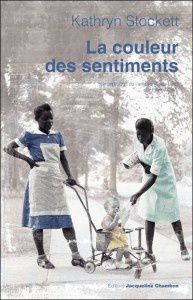 On pouvait s'attendre au pire avec le sujet du roman de Kathryn Stockett,
On pouvait s'attendre au pire avec le sujet du roman de Kathryn Stockett,  Lire un premier roman, c'est un peu comme entrer dans une nouvelle maison: bonne ou mauvaise surprise? Avec le premier roman de l'italien Alessandro de Roma,
Lire un premier roman, c'est un peu comme entrer dans une nouvelle maison: bonne ou mauvaise surprise? Avec le premier roman de l'italien Alessandro de Roma,  C'est par ces belles paroles, prononcées par Jaurès, que s'achève l'essai biographique de Jean-Pierre Rioux,
C'est par ces belles paroles, prononcées par Jaurès, que s'achève l'essai biographique de Jean-Pierre Rioux, 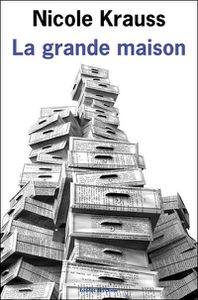 C'est l'histoire d'un bien étrange bureau! Il passe de mains en mains, prend une place centrale dans la vie des protagonistes et son origine reste plutôt mystérieuse. Il est au coeur du second roman de l'écrivain américain Nicole Krauss intitulé
C'est l'histoire d'un bien étrange bureau! Il passe de mains en mains, prend une place centrale dans la vie des protagonistes et son origine reste plutôt mystérieuse. Il est au coeur du second roman de l'écrivain américain Nicole Krauss intitulé