2 octobre 2011
7
02
/10
/octobre
/2011
08:52
 C'est bien connu, le soleil se lève à l'est! Aux Etats-Unis comme ailleurs et Boston n'échappe pas à la règle. C'est cette ville de la côte est, très européenne, qui sert de toile de fond au foisonnant roman de Denis Lehane, Un pays à l'aube.
C'est bien connu, le soleil se lève à l'est! Aux Etats-Unis comme ailleurs et Boston n'échappe pas à la règle. C'est cette ville de la côte est, très européenne, qui sert de toile de fond au foisonnant roman de Denis Lehane, Un pays à l'aube.
Nous sommes au lendemain de la Première Guerre Mondiale, fin 1918 et début 1919 et la société américaine ne ressort pas indemne du conflit: les soldats de retour du front doivent retrouver des emplois qui, effort de guerre oblige, ont été confiés à des noirs; ces derniers doivent céder la place. Les prix des denrées de base s'envolent tandis que les salaires stagnent: la police de Boston n'échappe pas à la règle et voit se développer en son sein un syndicalisme qui va mener à la première grève de l'histoire de ce corps de fonctionnaires. Des troubles sérieux de l'ordre public s'en suivront.
Au coeur du récit, deux hommes que tout oppose et qui vont pourtant se lier d'amitié, comme s'ils incarnaient un futur possible de la société américaine: un jeune policier blanc de famille irlandaise, fils d'un responsable de la police et qui devient leader syndicaliste en rompant avec son père; un jeune ouvrier noir, renvoyé de son travail, impliqué dans un règlement de compte et obligé de fuir sa ville et sa femme enceinte pour se refugier à Boston.
Leur destin croisé et entremêlé sert de moteur à un roman qui met en scène une nation américaine en pleine transformation, en proie aux intrigues politiques (à tour de rôle apparaissent le Président Wilson, Coolidge, un futur Président, et Edgar Hoover, bientôt tout puissant patron du FBI pour des décennies), à la violence, aux inégalités sociales déjà exacerbées et à un racisme profondément ancré dans la vie quotidienne (un noir ne doit s'adresser à un blanc qu'en l'appelant "patron"!).
Cette page de l'histoire américaine, magnifiquement narrée et qui se lit d'une traite, est sombre et sanglante, mais le soleil de l'espoir finit toujours par se lever sur la grande nation d'outre-atlantique.
Published by Lecteur-sur-le-net
-
dans
En lisant
10 septembre 2011
6
10
/09
/septembre
/2011
08:49
 A l'exercice, amusant d'ailleurs, qui consisterait à donner le nom d'une ville et d'un livre qui en serait le plus représentatif, il vient à l'esprit des dizaines de noms et d'oeuvres (Venise et Mort à Venise, New-York et Trilogie new-yorkaise, Los Angeles et Le Dalhia Noir, Barcelone et La sombra del viento...) mais peut-être pas Ferrare et Le jardin des Finzi-Contini de l'italien Giorgio Bassani. En ce qui me concerne, sans mon voyage en Italie de cet été, sans mon guide du Nord de l'Italie, je ne me serais pas soucié de découvrir cet auteur et cette oeuvre.
A l'exercice, amusant d'ailleurs, qui consisterait à donner le nom d'une ville et d'un livre qui en serait le plus représentatif, il vient à l'esprit des dizaines de noms et d'oeuvres (Venise et Mort à Venise, New-York et Trilogie new-yorkaise, Los Angeles et Le Dalhia Noir, Barcelone et La sombra del viento...) mais peut-être pas Ferrare et Le jardin des Finzi-Contini de l'italien Giorgio Bassani. En ce qui me concerne, sans mon voyage en Italie de cet été, sans mon guide du Nord de l'Italie, je ne me serais pas soucié de découvrir cet auteur et cette oeuvre.
Je n'ai pas visité Ferrare et je le regrette. Mais la ville est si présente, si vivante et en même temps si mystérieuse dans le livre de Bassani qu'en en terminant la lecture, je garde l'impression d'en connaître l'atmosphère et d'avoir peut-être un jour arpenté le long et solennel corso Ercole I d'Este qui longe le jardin de la famille Finzi-Contini.
Le narrateur appartient à la communauté juive de Ferrare et il fréquente, avant la seconde guerre mondiale, une famille de l'aristocratie juive, les Finzi-Contini. Il tombe amoureux de Micol, la jeune fille de la maison, et se lie d'amitié avec son frère. Tout cela sur fond de montée d'antisémitisme encouragé par le régime de Mussolini.
Mais le véritable "héros" du roman est ce jardin immense qui entoure la "magna domus" des Finzi-Contini, sorte de jardin d'Eden aux yeux du narrateur; jardin où l'on joue au tennis, où l'on sirote des orangeades, où l'on se prélasse au soleil ou à l'ombre d'arbres anciens, immenses et aux mille essences diverses. Jardin d'abord inaccessible au narrateur dans son enfance puis qui lui livre quelques uns de ses secrets uniquement par la grâce de son amitié pour les enfants Finzi-Contini. Puis il est chassé de cet Eden pour avoir commis une faute, celle de vouloir à tout prix aimer Micol qui, elle le repousse.
Le roman déjà si mélancolique s'achève par le drame de la déportation de l'ensemble des Finzi-Contini. Ultime et tragique punition interdisant à jamais l'accès au jardin (d'Eden) du corso Ercole I d'Este.
Published by Lecteur-sur-le-net
-
dans
En lisant
17 août 2011
3
17
/08
/août
/2011
09:29
 C'était il y a deux mille ans, c'était il y a bien longtemps et c'est pourtant si proche: la révolte des esclaves et gladiateurs romains en 73 avant JC, menée par Spartacus. C'est aussi un roman d'Arthur Koestler, publié en 1939 dans un contexte historique de tyrannie (fasciste et communiste) qui n'avait rien à envier au pouvoir absolu de la République romaine d'avant Jules César.
C'était il y a deux mille ans, c'était il y a bien longtemps et c'est pourtant si proche: la révolte des esclaves et gladiateurs romains en 73 avant JC, menée par Spartacus. C'est aussi un roman d'Arthur Koestler, publié en 1939 dans un contexte historique de tyrannie (fasciste et communiste) qui n'avait rien à envier au pouvoir absolu de la République romaine d'avant Jules César.
Outre la précision de la reconstitution historique et la qualité de la narration qui en font un récit tout à fait "cinématographique", l'intérêt du roman d'A. Koestler réside dans l'humanité du combat pour la liberté qu'a engagé le gladiateur Spartacus. Car cet homme, qui n'était qu'une machine à tuer ("tuer pour ne pas être tué", telle était la "philosophie" des combats de gladiateurs dont les très démocrates romains appréciaient tant le spectacle) se métamorphose en chef charismatique et surtout en homme, avec ses qualités et surtout ses faiblesses.
Au choeur du livre, se pose la question du pouvoir: Spartacus s'est révolté pour abattre l'oppression exercée par des hommes sur d'autres hommes et lorsqu'il se trouve à la tête d'une armée de cent mille hommes, il devient malgré lui un "imperator", un chef au pouvoir absolu qui, à son tour, exerce une tyrannie: "il était le seul voyant, les autres étaient aveugles. Il fallait une volonté, la volonté de celui qui sait... il avait le devoir de pousser son troupeau sur la route... il avait le devoir de protéger les intérêts [de ses hommes] contre leur propre déraison, par tous les moyens, par les plus cruels, par les plus incompréhensibles."
Et c'est là que Spartacus hésite: trop humain, il ne va pas jusqu'au terme de sa "révolution" qui aurait exigé d'être implacable. Il a des doutes et il renonce à justifier la fin par n'importe quels moyens. Son ultime rencontre avec le consul romain Crassus est une scène emblématique du roman: la puissance et la ruse du pouvoir romain sans état d'âme face à l'humanité d'un rebelle qui ne vient pas négocier son propre sort (il refuse la proposition de "sauf-conduit" de Crassus) mais celui de ses hommes.
Les doutes de Spartacus sont éternels et nous donnent une raison , malgré toutes les croix qui bordent le chemin de la victoire romaine sur les rebelles, de croire en l'humanité.
Published by Lecteur-sur-le-net
-
dans
En lisant
6 août 2011
6
06
/08
/août
/2011
12:08
 Picture, comme disent les américains: un petit village de France, les GIs qui s'installent à la fin de la guerre, deux adolescents découvrant l'amour adulte après les vertes amours enfantines, un père et un fils qui s'affrontent, la découverte des cigarettes américaines, du chocolat américain et surtout de la musique noire américaine.
Picture, comme disent les américains: un petit village de France, les GIs qui s'installent à la fin de la guerre, deux adolescents découvrant l'amour adulte après les vertes amours enfantines, un père et un fils qui s'affrontent, la découverte des cigarettes américaines, du chocolat américain et surtout de la musique noire américaine.
Tel est le décor du récit de Pascal Quignard intitulé L'occupation américaine. Une belle plume, un récit classique et entraînant, parcouru d'une tension grandissante et qui finira par la mort accidentelle d'un GI, le suicide d'une jeune fille et le départ du "héros" pour d'autres horizons... au moment même où les troupes américaines évacueront le sol français suite à la décision du Général de Gaulle de se retirer du commandement intégré de l'OTAN.
Il s'agit avant tout d'un récit d'apprentissage, du récit du passage de l'adolescence à l'âge adulte dans les incertitudes de l'après-guerre: les corps et les esprits changent comme la société française en pleine (r)évolution au contact de l'american way of life, pour le meilleur et pour le pire. Un angle de vue somme toute classique, un récit sans doute aussi vaguement autobiographique (puisque le petit Quignard avait 18 ans au moment du départ définitif des troupes américaines), un récit d'une grande justesse contemporaine puisqu'il est encore bien des lieux d'occupation.
L'occupation américaine c'est aussi (et ce sera toujours) le récit d'une... libération.
Published by Lecteur-sur-le-net
-
dans
En lisant
5 août 2011
5
05
/08
/août
/2011
18:23
 Les capitales ont toujours et font encore rêver tous les jeunes provinciaux en Chine comme en Argentine, en France comme au Portugal, dans les romans de Balzac ou ceux de Dickens comme dans celui d’Eça de Queiros, La Capitale.
Les capitales ont toujours et font encore rêver tous les jeunes provinciaux en Chine comme en Argentine, en France comme au Portugal, dans les romans de Balzac ou ceux de Dickens comme dans celui d’Eça de Queiros, La Capitale.
Ce roman de la fin du XIXème siècle raconte l’itinéraire d’un jeune homme épris de poésie, un temps exalté par les discussions enflammées des étudiants de l’Université de Coimbra et ennuyé par la monotonie de sa vie dans une petite ville de province. A la suite d’un petit héritage qui lui donne l’illusion de la richesse, il court à Lisbonne, délaissant le giron accueillant de ses vieilles tantes confites en manies et dévotion, et se lance à l’aveugle dans le tourbillon de la capitale. Las ! Ses désillusions seront à la hauteur de ses espérances…
On ne peut évidemment pas éviter la comparaison avec Rastignac et l’univers balzacien mais il y a dans de Queiros plus de finesse et une certaine mélancolie, peut-être proche du fado et de cette fameuse « saudade » si particulière au Portugal. Le jeune homme est si proche de chacun d’entre nous, un jour tenté par les chimères du succès, de la reconnaissance et de la vie brillante ; il est si naïf et si faible, si rêveur et si nigaud, si généreux et si balourd qu’il naît une connivence immédiate avec le lecteur, surtout celui qui a déjà ressenti les vibrants espoirs et les amères déceptions de la destinée littéraire.
Il se voyait déjà en haut en de l’affiche et au bout du récit, ignoré de tout et sans un sou en poche, il sera devenu un homme plus amer peut-être mais aussi plus lucide et plus conscient que c’est en puisant en soi et sans aveuglement que l’on écrit son destin en lettres… capitales.
Published by Lecteur-sur-le-net
-
dans
En lisant
24 juillet 2011
7
24
/07
/juillet
/2011
16:13
 Qui a oublié le Zorro de notre enfance, ce vengeur masqué, défenseur de la veuve et de l'orphelin dans une Californie opprimée par les Espagnols? Isabel Allende, écrivain chilien à succès et nièce de l'ancien Président renversé par la dictature de Pinochet, a publié en 2005 un Zorro qui nous plonge dans l'enfance, la jeunesse et les premiers pas du cavalier tout de noir vêtu et à l'épée prompte à marquer d'un Z les culottes ou les joues de l'ennemi espagnol.
Qui a oublié le Zorro de notre enfance, ce vengeur masqué, défenseur de la veuve et de l'orphelin dans une Californie opprimée par les Espagnols? Isabel Allende, écrivain chilien à succès et nièce de l'ancien Président renversé par la dictature de Pinochet, a publié en 2005 un Zorro qui nous plonge dans l'enfance, la jeunesse et les premiers pas du cavalier tout de noir vêtu et à l'épée prompte à marquer d'un Z les culottes ou les joues de l'ennemi espagnol.
Sous les charmes du bon vieux récit de "cape et d'épée", qui ne manque pas d'allant et se lit aisément, j'ai découvert un véritable parcours initiatique, un "roman d'apprentissage", qui donne de Diego de la Vega une image beaucoup plus complexe que celle, lisse et "marketing", des studios hollywoodiens de nos jeunes années. En effet, tout le roman est parcouru de la figure du double, de l'interrogation sur identité et métissage. Car Diego a du sang indien et son frère de lait, son double, est un véritable indien. Jamais, le noble hidalgo n'oublie ses racines et son séjour à Barcelone ne fera que renforcer cette appartenance à une culture métissée confrontée à la tyrannie et au mépris de l'aristocratie espagnole.
Le jeu du double, c'est aussi la construction progressive du personnage de Zorro, à la fois si semblable et si différent du jeune de La Vega. "Je est un autre" et nombreuses sont les interrogations de Diego sur cette ambiguïté de sa personnalité, son aspect "Docteur Jekyll et Mr Hyde". Son désir profond est d'être Zorro mais Zorro ne peut exister que si Diego de la Vega reste dans la lumière et brouille les pistes. Car Zorro est un animal nocturne, qui attaque par surprise et disparaît aussi vite qu'il n'est apparu. Il n'a droit à aucune reconnaissance et son secret est aussi son succès.
Plus profond, sous le récit, Isabel Allende nous parle aussi de toutes les tyrannies qui se sont abattues sur l'Amérique depuis la découverte de 1492, le massacre de cultures indiennes millénaires, l'oppression et la cupudité des colonisateurs. Cette même tyrannie, cette même oppression que sa famille a éprouvées dans sa chair lors du coup d'état chilien de 1973... sans que, hélas, n'apparaisse jamais la sombre silhouette sur fond de lune du vengeur masqué.
Published by Lecteur-sur-le-net
-
dans
En lisant
16 juillet 2011
6
16
/07
/juillet
/2011
08:50

Vermeer, le peintre hollandais du XVIIème siècle, reste un mystère à bien des égards: un mystère biographique car l'on ignore presque tout de sa vie; un mystère pictural car les experts du monde entier, et depuis bien longtemps, bataillent "d'arrache plume" sans jamais se mettre d'accord sur le nombre exact de tableaux authentiques du maître de Delft qui seraient arrivés jusqu'à nous.
"Authentique". Voilà le terme clé au coeur du roman de l'italien Luigi Guanieri, La double vie de Vermeer: qui peut vraiment affirmer qu'un Vermeer est un Vermeer? Et non un faux génial, comme ceux que le peintre hollandais des années 30, Van Meegeren (VM, tiens, tiens! des initiales qui nous rappellent quelqu'un!), a peints et vendus sans le moindre souci... du moins jusqu'à la chute des nazis et celle du boulimique collectionneur Goering, lequel s'est retrouvé en possession d'un splendide Vermeer... faux!
Est-ce vraiment un roman? Je dirais plutôt une suite de petits essais sur la peinture, entrecoupés de notices littéraires et historiques (un excellent passage sur le Proust de la fin de vie, grand admirateur de Vermeer, nous entraîne dans la rédaction du fameux passage de la Recherche sur la mort de l'écrivain Bergotte, en face de la Vue de Delft de Vermeer... un vrai celui-là). Tout le mérite de Luigi Guarnieri est de nous plonger dans l'analyse du style et de la maîtrise picturale de Vermeer... surtout grâce au faussaire Van Meegeren car il faut "prêcher le faux pour avoir le vrai", En effet, ce peintre, qui n'est pas reconnu par ses pairs, qui a été moqué et humilié par les experts de son temps, est assurément un génie du pinceau, un maître de l'illusion, un intime des génies de la peinture du siècle d'or hollandais (il ne s'arrête pas à Vermeer dans sa folie du faux...), sans doute leur égal. Guarnieri, en incipit, cite d'ailleurs ce mot de l'écrivain américain Ralph Emerson qui qualifie parfaitement le talent ambigü de notre VM moderne: "...seul un inventeur sait comment enprunter".
La grande leçon de ce petit livre est de nous donner à réfléchir sur ce qui fait la qualité d'une oeuvre d'art, sur ce qui fait la différence entre un chef d'oeuvre et une oeuvre de bonne facture (sur ce que d'aucuns, les fameux "experts", affirment être chef d'oeuvre), sur la limite très imprécise entre illusion et réalité, entre vrai et... faux. Et Vermeer continue de scintiller dans le mystère de ses oeuvres connues et inconnues... pour notre plus grand bonheur.
Published by Lecteur-sur-le-net
-
dans
En lisant
19 juin 2011
7
19
/06
/juin
/2011
00:00
 Le déjeuner sur l'herbe, d'Edouard Manet, tableau de tous les scandales, sert de point de départ au roman policier de Régis Descott intitulé Obscura. Nous sommes à la fin du XIXème siècle et un "serial killer" répète le tableau d'un des pères de l'Impressionnisme en y ajoutant sa touche personnelle: les personnages de la célèbre toile sont remplacés par des cadavres.
Le déjeuner sur l'herbe, d'Edouard Manet, tableau de tous les scandales, sert de point de départ au roman policier de Régis Descott intitulé Obscura. Nous sommes à la fin du XIXème siècle et un "serial killer" répète le tableau d'un des pères de l'Impressionnisme en y ajoutant sa touche personnelle: les personnages de la célèbre toile sont remplacés par des cadavres.
Un jeune médecin se voit entraîné à la poursuite de ce tueur en raison de la ressemblance d'une patiente et de sa femme avec le modèle que Manet a représenté dans son oeuvre. En toile de fond de l'intrigue apparaît aussi la fameuse clinique du docteur Blanche de Passy, en son temps fréquenté par Nerval. Car la monomanie est à l'ouvrage dans le récit, au moins autant que le mensonge et la dépravation: la syphilis, maladie aussi ravageuse en ce temps-là que le SIDA de nos jours, gangrène bon nombre des personnages et représente l'envers du décor d'un siècle de grand développement industriel.
Les amateurs de peinture, et de Manet en particulier, apprécieront ce "thriller". Les amateurs de bonne littérature trouveront sans doute, comme moi, un peu poussif et plat le récit, et très irritante la manie qu'a l'auteur d'expliquer en long, large et travers à son lecteur les développements d'un récit dont l'évolution reste assez largement "cousue de fil blanc" et ne laisse guère de zones... d'ombre.
Published by Lecteur-sur-le-net
-
dans
En lisant
10 juin 2011
5
10
/06
/juin
/2011
16:43
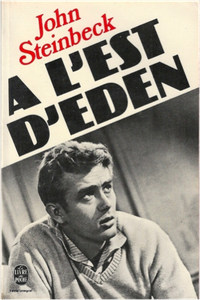 A l'ouest rien de nouveau, comme on le sait, mais en revanche à l'est il se passe toujours quelque chose, de Fukushima à la bactérie tueuse allemande. Et il faut relire John Steinbeck pour comprendre.
A l'ouest rien de nouveau, comme on le sait, mais en revanche à l'est il se passe toujours quelque chose, de Fukushima à la bactérie tueuse allemande. Et il faut relire John Steinbeck pour comprendre.
Car à la fin de la première partie d' A l'est d'Eden, fabuleuse épopée "californicatrice" (pour reprendre une expression contemporaine et, ma foi, assez pertinente!) d'une famille dans la vallée de la Salinas (Californie du Nord) au début du 20ème siècle, il est rappelé un épisode biblique fondateur: Caïn tue Abel et doit s'éloigner de Dieu ("... puis Caïn s'éloigna de la face de l'Eternel et habita dans la terre de Nod, à l'est d'Eden."). Et dans le splendide chapitre d'introduction au roman, le narrateur qui décrit la vallée de la Salinas précise qu'il a toujours préféré l'est de la vallée à l'ouest.
Et cette vallée californienne, c'est à la fois la terre promise et le paradis perdu, à l'image des cycles de pluie et de sécheresse qui font la richesse ou la ruine des fermiers qui y vivent. Tout le roman est parcouru de la symbolique biblique du bien et du mal: le personnage central s'appelle Adam, ses fils Caleb et Aaron (toute similitude avec un certain Caïn et un certain Abel est purement fortuite!), sa femme Cathy est le démon incarné (ah, cette affaire de pomme qui poursuivra éternellement nos malheureuses compagnes!).
Le dernier mot de ce roman éblouissant est un terme de la langue hébraïque: "timshel" qui signifie "tu peux". C'est le mot de la fin et assurément la clé de voûte du récit: entre le bien et la mal, l'homme a le choix, et surtout la rédemption est toujours possible, même dans la moins verte des vallées.
Published by Lecteur-sur-le-net
-
dans
En lisant
30 mai 2011
1
30
/05
/mai
/2011
14:04
 Jorge Edwards est un diplomate et écrivain chilien contemporain qui commence à être connu en France où il a longtemps séjourné, notamment comme ambassadeur de son pays. Dans son dernier ouvrage, essai plus que roman (bien qu'il parle lui-même de roman), La mort de Montaigne, il déambule librement dans les dernières années de Michel Eyquem, seigneur de Montaigne, au gré des annotations biographiques qui sont la chair même des Essais et des événements politiques qui secouent le royaume de France en ces temps de guerres de religion.
Jorge Edwards est un diplomate et écrivain chilien contemporain qui commence à être connu en France où il a longtemps séjourné, notamment comme ambassadeur de son pays. Dans son dernier ouvrage, essai plus que roman (bien qu'il parle lui-même de roman), La mort de Montaigne, il déambule librement dans les dernières années de Michel Eyquem, seigneur de Montaigne, au gré des annotations biographiques qui sont la chair même des Essais et des événements politiques qui secouent le royaume de France en ces temps de guerres de religion.
Je ne sais pas s'il en existe déjà une traduction française, quoi qu'il en soit le texte en espagnol révèle malgré tout une grande connivence de l'auteur chilien avec son lointain collègue français, tant dans la philosophie de vie et d'écriture que dans une certaine tolérance politique. Car l'ouvrage tisse sa trame autour de quelques fils de couleurs différentes, celui de l'amour d'un vieil homme pour une jeune fille pleine d'admiration et de fraîcheur, celui d'une situation politique presque inextricable entre catholiques et protestants (non sans une certaine concordance avec les affrontements mortifères de l'ère Pinochet), celui de la passion des livres et de l'écriture et enfin celui de l'approche, sereine pour Montaigne, qu'il voudrait apaisée pour Edwards, de la mort.
Il y a beaucoup d'admiration, dans ce livre, pour la littérature et la culture françaises mais les meilleurs passages sont ceux qui abordent les événements politiques qui bouleversent la France de la fin du XVIème siècle de la Saint-Barthélémy à l'abjuration du protestantisme par Henri IV en passant par l'assassinat d'Henri III, dernier des Valois à régner sur la France. J. Edwards s'appuye notamment sur l'Histoire de France de J. Michelet pour donner vie à cette période tragique et fondatrice de notre pays. Et puis, et puis... il y a Marie de Gournay, la passion crépusculaire de Montaigne que l'écrivain chilien aborde avec un luxe d'allusions sexuelles qui font penser, hélas, qu'il est lui-même en proie aux ultimes sursauts d'une sensualité digne de celle du... Vert Galant!
Published by Lecteur-sur-le-net
-
dans
En lisant
 C'est bien connu, le soleil se lève à l'est! Aux Etats-Unis comme ailleurs et Boston n'échappe pas à la règle. C'est cette ville de la côte est, très européenne, qui sert de toile de fond au foisonnant roman de Denis Lehane, Un pays à l'aube.
C'est bien connu, le soleil se lève à l'est! Aux Etats-Unis comme ailleurs et Boston n'échappe pas à la règle. C'est cette ville de la côte est, très européenne, qui sert de toile de fond au foisonnant roman de Denis Lehane, Un pays à l'aube. 


 A l'exercice, amusant d'ailleurs, qui consisterait à donner le nom d'une ville et d'un livre qui en serait le plus représentatif, il vient à l'esprit des dizaines de noms et d'oeuvres (Venise et Mort à Venise, New-York et Trilogie new-yorkaise, Los Angeles et Le Dalhia Noir, Barcelone et La sombra del viento...) mais peut-être pas Ferrare et
A l'exercice, amusant d'ailleurs, qui consisterait à donner le nom d'une ville et d'un livre qui en serait le plus représentatif, il vient à l'esprit des dizaines de noms et d'oeuvres (Venise et Mort à Venise, New-York et Trilogie new-yorkaise, Los Angeles et Le Dalhia Noir, Barcelone et La sombra del viento...) mais peut-être pas Ferrare et  C'était il y a deux mille ans, c'était il y a bien longtemps et c'est pourtant si proche: la révolte des esclaves et gladiateurs romains en 73 avant JC, menée par
C'était il y a deux mille ans, c'était il y a bien longtemps et c'est pourtant si proche: la révolte des esclaves et gladiateurs romains en 73 avant JC, menée par  Picture, comme disent les américains: un petit village de France, les GIs qui s'installent à la fin de la guerre, deux adolescents découvrant l'amour adulte après les vertes amours enfantines, un père et un fils qui s'affrontent, la découverte des cigarettes américaines, du chocolat américain et surtout de la musique noire américaine.
Picture, comme disent les américains: un petit village de France, les GIs qui s'installent à la fin de la guerre, deux adolescents découvrant l'amour adulte après les vertes amours enfantines, un père et un fils qui s'affrontent, la découverte des cigarettes américaines, du chocolat américain et surtout de la musique noire américaine. Les capitales ont toujours et font encore rêver tous les jeunes provinciaux en Chine comme en Argentine, en France comme au Portugal, dans les romans de Balzac ou ceux de Dickens comme dans celui d’Eça de Queiros,
Les capitales ont toujours et font encore rêver tous les jeunes provinciaux en Chine comme en Argentine, en France comme au Portugal, dans les romans de Balzac ou ceux de Dickens comme dans celui d’Eça de Queiros, Qui a oublié le Zorro de notre enfance, ce vengeur masqué, défenseur de la veuve et de l'orphelin dans une Californie opprimée par les Espagnols? Isabel Allende, écrivain chilien à succès et nièce de l'ancien Président renversé par la dictature de Pinochet, a publié en 2005 un
Qui a oublié le Zorro de notre enfance, ce vengeur masqué, défenseur de la veuve et de l'orphelin dans une Californie opprimée par les Espagnols? Isabel Allende, écrivain chilien à succès et nièce de l'ancien Président renversé par la dictature de Pinochet, a publié en 2005 un 
 Le déjeuner sur l'herbe, d'Edouard Manet, tableau de tous les scandales, sert de point de départ au roman policier de Régis Descott intitulé Obscura. Nous sommes à la fin du XIXème siècle et un "serial killer" répète le tableau d'un des pères de l'Impressionnisme en y ajoutant sa touche personnelle: les personnages de la célèbre toile sont remplacés par des cadavres.
Le déjeuner sur l'herbe, d'Edouard Manet, tableau de tous les scandales, sert de point de départ au roman policier de Régis Descott intitulé Obscura. Nous sommes à la fin du XIXème siècle et un "serial killer" répète le tableau d'un des pères de l'Impressionnisme en y ajoutant sa touche personnelle: les personnages de la célèbre toile sont remplacés par des cadavres.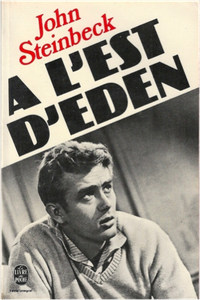 A l'ouest rien de nouveau, comme on le sait, mais en revanche à l'est il se passe toujours quelque chose, de Fukushima à la bactérie tueuse allemande. Et il faut relire John Steinbeck pour comprendre.
A l'ouest rien de nouveau, comme on le sait, mais en revanche à l'est il se passe toujours quelque chose, de Fukushima à la bactérie tueuse allemande. Et il faut relire John Steinbeck pour comprendre. Jorge Edwards est un diplomate et écrivain chilien contemporain qui commence à être connu en France où il a longtemps séjourné, notamment comme ambassadeur de son pays. Dans son dernier ouvrage, essai plus que roman (bien qu'il parle lui-même de roman),
Jorge Edwards est un diplomate et écrivain chilien contemporain qui commence à être connu en France où il a longtemps séjourné, notamment comme ambassadeur de son pays. Dans son dernier ouvrage, essai plus que roman (bien qu'il parle lui-même de roman),