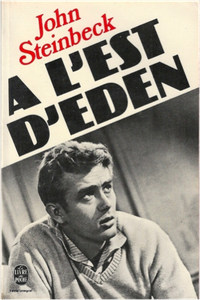 A l'ouest rien de nouveau, comme on le sait, mais en revanche à l'est il se passe toujours quelque chose, de Fukushima à la bactérie tueuse allemande. Et il faut relire John Steinbeck pour comprendre.
A l'ouest rien de nouveau, comme on le sait, mais en revanche à l'est il se passe toujours quelque chose, de Fukushima à la bactérie tueuse allemande. Et il faut relire John Steinbeck pour comprendre.
Car à la fin de la première partie d' A l'est d'Eden, fabuleuse épopée "californicatrice" (pour reprendre une expression contemporaine et, ma foi, assez pertinente!) d'une famille dans la vallée de la Salinas (Californie du Nord) au début du 20ème siècle, il est rappelé un épisode biblique fondateur: Caïn tue Abel et doit s'éloigner de Dieu ("... puis Caïn s'éloigna de la face de l'Eternel et habita dans la terre de Nod, à l'est d'Eden."). Et dans le splendide chapitre d'introduction au roman, le narrateur qui décrit la vallée de la Salinas précise qu'il a toujours préféré l'est de la vallée à l'ouest.
Et cette vallée californienne, c'est à la fois la terre promise et le paradis perdu, à l'image des cycles de pluie et de sécheresse qui font la richesse ou la ruine des fermiers qui y vivent. Tout le roman est parcouru de la symbolique biblique du bien et du mal: le personnage central s'appelle Adam, ses fils Caleb et Aaron (toute similitude avec un certain Caïn et un certain Abel est purement fortuite!), sa femme Cathy est le démon incarné (ah, cette affaire de pomme qui poursuivra éternellement nos malheureuses compagnes!).
Le dernier mot de ce roman éblouissant est un terme de la langue hébraïque: "timshel" qui signifie "tu peux". C'est le mot de la fin et assurément la clé de voûte du récit: entre le bien et la mal, l'homme a le choix, et surtout la rédemption est toujours possible, même dans la moins verte des vallées.




 Jorge Edwards est un diplomate et écrivain chilien contemporain qui commence à être connu en France où il a longtemps séjourné, notamment comme ambassadeur de son pays. Dans son dernier ouvrage, essai plus que roman (bien qu'il parle lui-même de roman),
Jorge Edwards est un diplomate et écrivain chilien contemporain qui commence à être connu en France où il a longtemps séjourné, notamment comme ambassadeur de son pays. Dans son dernier ouvrage, essai plus que roman (bien qu'il parle lui-même de roman),  Donner la parole aux animaux entre dans une longue tradition littéraire, sans parler des relais contemporains que sont les bandes dessinées et les cartoons à la Walt Dysney: du
Donner la parole aux animaux entre dans une longue tradition littéraire, sans parler des relais contemporains que sont les bandes dessinées et les cartoons à la Walt Dysney: du  troupeau... et peut-être même du monde..."
troupeau... et peut-être même du monde..." Dans le roman de l'auteur espagnol Pérez-Reverte, intitulé
Dans le roman de l'auteur espagnol Pérez-Reverte, intitulé  Au bord de la Baltique, traversée par la Neva, sur le 60ème parallèle nord, au milieu d'une zone insalubre et marécageuse, pas très loin du cercle polaire artique, une ville, fondée il y a peine trois cents ans par la seule volonté inflexible d'un homme, nous livre quelques uns des plus beaux chefs d'oeuvre artisitiques de l'humanité!
Au bord de la Baltique, traversée par la Neva, sur le 60ème parallèle nord, au milieu d'une zone insalubre et marécageuse, pas très loin du cercle polaire artique, une ville, fondée il y a peine trois cents ans par la seule volonté inflexible d'un homme, nous livre quelques uns des plus beaux chefs d'oeuvre artisitiques de l'humanité! 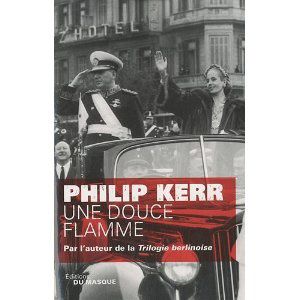 Il faut lire à la suite les deux derniers opus de la saga historique "Bernie Gunther" de Philip Kerr, respectivement intitulés
Il faut lire à la suite les deux derniers opus de la saga historique "Bernie Gunther" de Philip Kerr, respectivement intitulés 